 1er Dimanche de l’Avent 1969 :
1er Dimanche de l’Avent 1969 :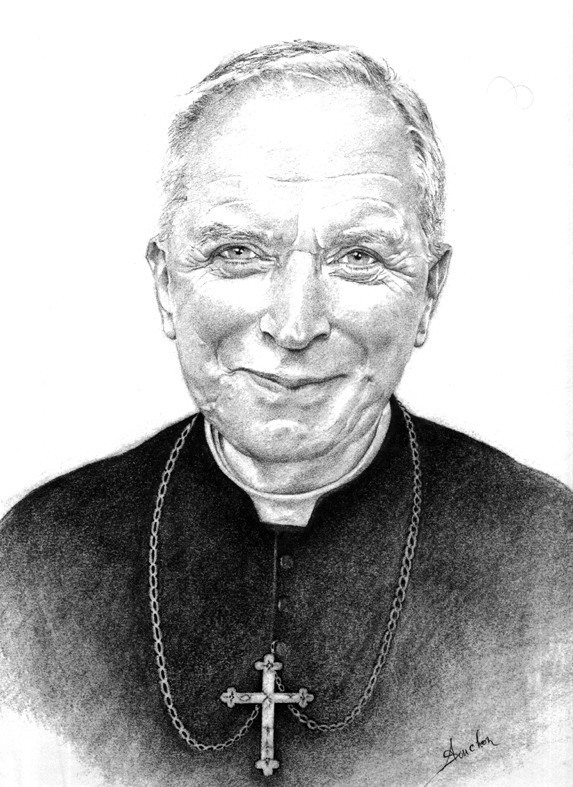
La Reconquête…
Nous la méditons pour l’entreprendre activement en ce début de nouveau millénaire. Mais, pour certains, elle a commencé dès la promulgation de la Nouvelle Messe, en 1969. Il s’agissait alors de reconquérir les paroisses qui se vidaient et de préserver la Messe tridentine. Cette Reconquête là se poursuit aujourd’hui, plus que jamais. Retour quelques années en arrière sur ce qui est l’Histoire de la Tradition catholique…
 1er Dimanche de l’Avent 1969 :
1er Dimanche de l’Avent 1969 :
Il parait que, maintenant, même à Rome on est d’accord pour se débarrasser de tous ces " articles de brocante ". L’autel est retourné, les statues vendues, les ornements brûlés, jetés ou définitivement enfermés dans les placards, les lustres de bronze et de cristal décrochés, les stalles de chœur démontées, les orgues délaissés et le latin oublié. Désormais, ce doit être le " printemps de l’Eglise ". Des estrades et des sonos, des guitares et des banjos, le prêtre est le " président de l’assemblée des fidèles ". Il doit leur parler tourné vers eux, dans un langage et avec des mots qu’ils comprennent, sur des sujets qui les concernent, sur de la musique qu’ils aiment.
Combien sont les paroisses où cela s’est passé comme cela ? Même Brassens et Sardou chantent leur désolation devant un tel vide liturgique.
Certes, le 11 octobre 1962, lors de l’ouverture du concile Vatican II, le Pape Jean XXIII l’avait défini par "l’aggiornamento ", mot ambigu signifiant aussi bien " mise au jour " (émergences de vérité) que " mise à jour " (remise en question d’un ordre). Le programme se voulait novateur : réforme de l’Eglise face au monde moderne. Réformateur, oui, mais à ce point là : c’était une révolution ! Ce n’était plus la doctrine catholique ! A y perdre son latin !
Pourtant, des ecclésiastiques s’étaient, dès le début du Concile, organisés pour résister contre ces réformes. A leur tête, Monseigneur Marcel Lefebvre, Supérieur général des Spiritains, assistant au Trône Pontifical, ancien Archevêque de Dakar, ancien délégué apostolique (c’est-à-dire représentant du Saint-Siège) pour tout le continent africain, ancien évêque de Tulle. Avec le Coetus Internationalis Patrum, auquel adhèrent 250 évêques, c’est la défense de l’immuable magistère de l’Eglise qui s’était organisé contre les idées libérales et modernistes.
Mais, le 7 décembre 1965, le dernier acte de la tragédie conciliaire s’était déjà joué. Totalement contraire au magistère constant de l’Eglise, la déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) était adoptée. Ainsi était accomplie et proclamée, par les évêques eux-mêmes, l’auto-destruction de l’Eglise catholique. La révolution était faite : l’Eglise n’est plus ni une ni unique, le Christ-Roi est découronné, la Babel des religions s’élève dans le ciel romain.
Alors, parmi toutes ces mitres,
où est la fidélité à Rome ?
Qui reste catholique ?
Devant une telle tragédie, Mgr Lefebvre, resté le seul évêque à résister, décide de fonder un séminaire afin de former de saints prêtres, selon l’enseignement traditionnel de l’Eglise. Il choisit Fribourg où il a l’amitié de l’évêque, Mgr Charrière. Le 1er novembre 1970, la jeune fraternité sacerdotale saint Pie X est reconnue par l’évêque. Trop à l’étroit, le Séminaire s’installe bientôt à Ecône, dans le Valais suisse, dans une propriété des Chanoines du Grand-Saint-Bernard. A la rentrée 1971, il sont 27 séminaristes et 9 professeurs. Le 17 octobre, la fraternité devient effectivement sacerdotale avec l’ordination de l’abbé Paul Aulagnier, ancien du Séminaire français de Rome.
Cette nouvelle Messe imposée, les cardinaux Ottaviani et Bacci l’avaient vivement critiqué dans leur Bref examen critique, comme douteuse et équivoque. En France, beaucoup de prêtres l’accueillent avec résignation ; moins souvent avec satisfaction. Mais quelques-uns refusent catégorique-ment. " Toute liturgie que nous aurions vue commencer, qui n’eût point été celle de nos pères, ne saurait donc mériter ce nom " affirmait déjà Dom Guéranger. Les églises sont alors fermées pour tous ceux qui veulent poursuivre le rite codifié au concile de Trente par le Pape Saint Pie V (1571). Des laïcs se rassemblent, louent des salles de cinéma, de spectacle, aménagent des garages, des granges ou même leur salon en chapelles de fortune. Faut-il que ces prêtres qui chantent leurs Messes dans de tels lieux est la Foi bien accrochée pour accepter ce destin d’exclus, de parias.
A Paris, Mgr François Ducaud-Bourget, chapelain conventuel de l’Ordre de Malte, poète, critique littéraire, aumônier de l’hôpital Laënnec loue la salle Wagram, temple de la boxe et de la danse, pour y célébrer la sainte Messe.
Des prêtres s’illustrent par leur résistance active. L’Abbé Georges de Nantes, curé de Villemaux (Aube), l’abbé Louis Coache curé de Montjavoult (Oise), l’abbé Philippe Sulmont, curé de Domqueur (Somme), l’abbé Jean Charron, curé de Saint-Léger–Vauban (Morvan), l’abbé Jean Espitallier, curé de Serres (Hautes-Alpes), l’abbé Montgommery-Wright, curé du Chamblac (Normandie), et bien d’autres encore. Tous s’opposent à leurs évêques, sont parfois suspendus, organisent de grandes processions, des pèlerinages (à Lourdes, à Rome), des conférences (notamment à la Mutualité), publient des revues (Le combat de la foi, la Contre-Réforme catholique…)
Ils sont nombreux à s’illustrer dans la défense de la Messe tridentine, de façon médiatique ou plus discrètement pour éviter les heurts avec les supérieurs. L’association Noël Pinot, du nom du prêtre guillotiné par les révolutionnaires, rassemblent beaucoup de ces " prêtres réfractaires " qui doivent souvent faire de nombreux kilomètres pour célébrer la Messe partout où les fidèles la réclament. La moisson est grande mais les ouvriers peu nombreux…
Des communautés religieuses (bénédictines, dominicaines, capucines, etc.) veulent, elles aussi, conserver le rite multi séculaire (Dom Gérard, Mère Marie-Gabrielle…) et l’on trouve aussi des hommes qui sont plutôt des inspirateurs ou des conseillers, comme le Père de Chivré, le Chanoine Poncelet, le Chanoine Berthod, le Père Reveilhac, Dom Guillou, le R-P Auvray, etc.
Et les laïcs ?
André Figuéras nous les décrit (in Les catholiques de Tradition, éd. de l’Orme rond): "Bien sûr, ce ne sont pas tous des saints ! Quelques-uns ont les défauts de leur courage, une petite pointe de vanité ou de sectarisme, une petite tendance à se prendre pour des "Purs ", pour des " Parfaits ". Toutes ces petites choses sans réelle importance n’ôtent rien aux dévouements qui se manifestent, aux sacrifices qui se répètent, aux nombreux kilomètres parcourus, et pas toujours commodément, pour assister à une Messe traditionnelle ; aux sommes prises, non seulement sur le plaisir, mais bien souvent sur son nécessaire, pour permettre l’acquisition d’un prieuré, la construction d’une chapelle.
Il n’est pas négligeable, aussi, de prendre en compte, pour ces catholiques de tradition, le drame que représente pour eux celui d’une séparation qu’ils espèrent provisoire. Quelle rupture déchirante pour celui qui décide d’abandonner la paroisse de son village ou de son quartier. N'était-ce pas l'église de ses joies et de ses peines, celle de ses premières approches de Dieu ? Etrange dilemme pour ces fidèles qui, ne voulant pas " mourir protestants " quittent leurs églises pour une grange ou une chapelle perdue, tandis que les proches refusant de les comprendre tentent de les marginaliser. Ces traditionalistes, c’est vrai que leur personnalité est parfois un peu mouvementée ; mais quand on constate leur générosité, leur esprit de sacrifice, leur prodigalité de leur temps, l’inlassable répétition de leur dévouement (car voilà longtemps que tout cela dure, et ce qui est long est long), la première chose que l’honnêteté force à dire, c’est que l’on ne se trouve pas en présence d’insoumis, de rebelles, mais de gens qui comptent nécessairement parmi les meilleurs fils de l’Eglise, les plus attentionnés, les plus respectueux, et que seule une situation dramatique paradoxale écarte en apparence de ce qui leur est le plus cher. (…) Ce sont tout bonnement des catholiques meurtris, et qui n’aspirent qu’à se retrouver dans l’ordre d’une Eglise redevenue elle-même. Campés sur les ruines que, l’on doit le reconnaître objectivement, le Concile a accumulées, ils se sont rassemblés pour préserver une flamme fragile dont ils comptent bien qu’elle redeviendra, à l’intention de tous, la lumière éternelle. "
En l’année jubilaire 1975, la fraternité Saint Pie X est supprimée et Mgr Lefebvre interdit de célébrer la Messe et d’ordonner des prêtres. Pourtant, en août 1976, ce sont 8.000 personnes qui assistent à la Messe pontificale célébrée par Mgr Lefebvre dans un hangar du palais des sports de Lille. Là, il prononce devant les caméras une homélie qui fait grand bruit : " Laissez-nous pratiquer la religion de nos pères " réclame-t-il. Partout, des Messes " interdites " sont célébrées. Les fidèles affluent et les media s’emparent de ces événements.
Mais tous en ont assez de devoir assister à la Messe dans des lieux de fortune. Alors, de véritables églises commencent à être obtenues ou achetées, ici ou là, comme à Marseille, à Tours ou à Orléans. Mais, à Paris, les fidèles, sans cesse plus nombreux, doivent toujours se contenter de la salle Wagram ou des arènes de Lutèce. Le dimanche 27 février 1977, tous les traditionalistes de la région parisienne sont conviés à la Mutualité. Au fur et à mesure que ceux-ci arrivent, on les fait entrer discrètement dans l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, juste à côté. Le curé achevait sa messe en français sur une petite table dressée sur une estrade, quand il voit son église à peu près vide se remplir. Le Credo est entonné tandis que s’avance vers le maître autel un cortège d’enfants de chœur et de prêtres en ornements. La Messe tridentine est célébrée devant un millier de fidèles. Le dernier évangile achevé, Mgr Ducaud-Bourget, les abbés Coache, Serralda (ancien vicaire dans cette église St-Nicolas), Juan, de Fommervault et tous les fidèles restent perplexes : ils sont maîtres de la place ! La décision est vite prise : on reste tant que l’on pourra ! De nombreuses personnalités interviennent en faveur de ces traditionalistes. C’est finalement le statut quo qui triomphe. " Nos 40 prêtres et nos 140 séminaristes de toutes nationalités, nos frères, nos religieuse, nos 20 maisons, dont 3 séminaires, fondés en 8 ans, sont une preuve que Dieu nous vient en aide " dira Mgr Lefebvre en octobre 1977. " Et si demain, il s’avérait que les hommes qui occupent les postes d’autorité reprennent une ligne droite, nous serions les premiers à leur demander leur bénédiction et à leur dire : nous sommes à votre service. "
Dans le même temps où s’opèrent ces premières puissantes manifestations de résistance, des laïcs célèbres, poignés par la même angoisse, attachés aux mêmes valeurs, soutiennent par leurs écrits ou leur parole le mouvement de contestation sacrée qui prend chaque jour une figure plus considérable. On trouve ainsi l’écrivain Michel de Saint-Pierre (Les nouveaux prêtres, Les fumées de Satan) et le Père Brückberger, homme de lettre fougueux, journaliste percutant, cinéaste de grand renom qui, dans Le Figaro-l’Aurore, veut faire comprendre au grand public qu’il ne s’agit pas d’une querelle de clocher ou de l’entêtement de quelques réactionnaires mais d’un problème fondamental essentiel pour la foi. Il y a aussi Louis Salleron, économiste (Les catholiques et le capitalisme, Diffuser la propriété, La nouvelle Messe, Dix dialogues su la crise de l’Eglise), qui œuvre à la revue Itinéraire avec Jean Madiran ; le philosophe Gustave Thibon, penseur et philosophe, (L’échelle de Jacob, Nietzsche ou le déclin de l’esprit, Notre regard qui manque à la lumière, L’ignorance étoilé) Jacques Perret, et même l’acteur Louis de Funès. Plusieurs écrivains de renoms et même académiciens français comme Michel Droit, Julien Green, Jean Dutourd ou Jean Guitton apportèrent à leur heure un soutien précieux. Bref, c’est toute une résistance qui s’organise.
Des associations de laïcs se créent partout en France, mais aussi à l’étranger, pour restaurer le rite tridentin, par différents moyens : publication de revues, organisation de pèlerinages, actions contre les concerts de rock dans les églises, etc.
Le 23 septembre 1979
, Mgr Lefebvre célèbre à Paris, porte de Versailles, la Messe de son Jubilé sacerdotal devant 25.000 personnes. Il appelle tous les catholiques à entreprendre une Croisade pour restaurer la royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les familles, dans les cités, dans les nations... Dix ans plus tard, le 15 août 1989, après une Messe solennelle célébrée place du Louvre, ce sont 50.000 personnes qui processionnent dans les rues de Paris.1er Dimanche de l’Avent 1999 :
cela fait trente ans que le Novus Ordo Missae, la nouvelle Messe, a été promulgué. Ce qui se voulait le " printemps de l’Eglise " n’a été que le printemps de la ruine. Malgré l’affluence des JMJ, les paroisses n’ont pas cessé de se vider et les vocations de décliner. Ces trente années ont vu se confirmer ce que prophétisaient les catholiques de Tradition : la doctrine est de plus en plus bafouée, l’Eglise se renie chaque jour un peu plus, les excès sont sans cesse plus nombreux. Il y a eu entre autres le scandale d’Assise en 1986, où toutes les religions se sont retrouvées dans la ville de Saint François pour célébrer l’œcuménisme. A cette occasion, les églises ont vu les bouddhas sur les autels, les tapis de prière étalés et de nombreuses sacrilèges accomplis. Alors que ces mêmes églises sont fermées aux catholiques de la Tradition…Août 2000 :
De nombreux fidèles de la Tradition se rendent en pèlerinage à Rome. Les Basiliques romaines sont envahies par une foule recueillie qui récite les prières indulgencielles. " L‘un des pèlerinages les plus édifiants que j’ai vus pendant cette Année Sainte " dira Mgr Tavanti, responsable liturgique de la Basilique Sainte Marie Majeure.25 mars 2001 :
Mgr Lefebvre est décédé depuis 10 ans, non sans avoir préparé sa succession en sacrant quatre évêques, en 1988, ce qui valut une condamnation inique. D’autres évêques l’avaient rejoint : le Brésilien Mgr de Castro-Mayer et le Philippin Mgr Lazo, tous deux eux aussi décédés. La fraternité Saint Pie X compte aujourd’hui plus de 500 prêtres, des frères, des religieuses, 5 séminaires (France, Suisse, Allemagne, USA, Argentine), et partout dans le monde des prieurés, des églises, des chapelles et des écoles, à quoi s’ajoutent toutes les autres communautés conservant elles aussi le rite tridentin. En France, 1 ordination sur 5 l’est pour la Tradition et 50% des séminaristes diocésains ont songé à rejoindre une communauté traditionnelle (Cardinal Ratzinger, Spectacle du monde, déc. 2000). Le phénomène est identique dans de nombreux pays d’Europe. Aux Etats-Unis, en Argentine, en Pologne, en Allemagne, les témoignages se multiplient, émanant le plus souvent du jeune clergé : " En tant que prêtre, j’ai le très fort désir de passer à la messe traditionnelle, à cause de la richesse spirituelle qui semble en émaner. Plus je l’examine, plus je la connais, et plus je vois combien nous a été retiré. " Les esprits évoluent énormément. On parle de rapprochements possibles avec Rome. En tous cas, un travail considérable a été accompli. Une véritable Reconquête a été entreprise. Les fondations sont solides.A nous désormais de poursuivre la tâche. A nous de semer encore…
Pour en savoir plus :
- Les catholiques de Tradition, André Figuéras, Ed. de l’Orme rond
- Monseigneur Lefebvre et la fraternité, P. Héduy, Ed. Fideliter.